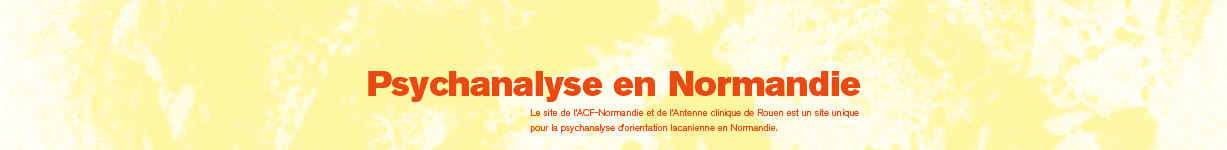ACF-NORMANDIE

- Présentation de l’ACF
-
Séminaires de l’ACF et activités des membres
- - ACF 2023-24 : les archives.
- - ACF 2022-23 : les archives.
- - ACF 2021-22 : les archives.
- - ACF 2020-21 : les archives.
- - ACF 2019-20 : les archives
- - ACF 2018-19 : les archives
- - ACF 2017-18 : les archives
- - ACF 2016-17 : les archives
- - ACF 2015-16 : les archives
- - ACF 2014-15 : les archives
- - ACF 2013-14 : les archives
- - ACF 2012-13 : les archives
- - ACF 2011-12 : les archives
- - ACF 2010-11 : les archives
- Cartels de l’ECF
Recherche
Par activités
- Activités ROUEN
- Activités LE HAVRE
- Activités EURE
- Activités CAEN
- Activités CHERBOURG
- Rouen archives
- Le Havre archives
- Eure archives
- Caen archives
- Cherbourg archives
- À ÉCOUTER
- AUTISME
Publié le dimanche 13 novembre 2022
Les membres proposent... 2022-23
Studiolo
Les mercredi 7 décembre, jeudis 12 janvier, 2 mars, 30 mars, 4 mai, 8 juin, 29 juin - 21h – Visioconférence

Lecture à plusieurs du livre d’Éric Laurent L’envers de la biopolitique. Une écriture pour la jouissance
Plusieurs membres de l’ACF en Normandie se réunissent par zoom chaque mois pour lire ensemble et commenter le livre d’Éric Laurent, dans un aller et retour avec les textes de Lacan que lui-même commente.
S’en dégagent les perspectives nouvelles hque le dernier enseignement de Lacan met à jour pas sans se référer à l’ensemble de son enseignement.
![]() Jeudi 17 novembre Mercredi 7 décembre
Jeudi 17 novembre Mercredi 7 décembre
Nous poursuivrons notre lecture du chapitre « Joyce et la pragmatique du saint homme » à la partie intitulée « Le saint et la castration ». Mais auparavant, Marie-Hélène Doguet Dziomba reprendra la question de la nature, à partir du premier chapitre du séminaire Le Sinthome.
Lors de notre précédente rencontre, une phrase nous avait interpellés : « Lacan met en cause ce point de départ de l’artiste, puisque, dès que Joyce se nomme artiste, il se met en face de la nature, c’est-à-dire qu’il s’en extrait1 ». Marie-Hélène ayant pensé à une citation issue du séminaire XXIII2, nous en a fait lecture, permettant d’éclairer la notion de nature en tant que n’étant « pas une », précisant que du fait même de la nommer, la nature s’affirme d’être un « pot-pourri de hors nature ». C’est-à-dire qu’en la distinguant par son nom, elle devient un pot-pourri de hors nature et donc, elle n’est pas une. Ce que Lacan amène ici, avec la nomination, c’est la question du pas-tout. Parce que, dès lors que l’on nomme des choses, on ne peut les nommer que une par une.
Cela éclaire le fait que dès que quelque chose s’ajoute au réel, ça dénature. Lacan, dans ce texte ne va pas du côté du Nom-du-Père, mais du côté du pas-tout. Il ne s’agit pas de dire que le sexe n’est rien de naturel, mais de savoir ce qu’il en est dans chaque cas : « de la bactérie à l’oiseau », tout ce qui peut être nommé. Et, nous précise Lacan, tout ce qu’Adam a nommé, il l’a fait dans la langue d’Eve. Ainsi, lorsque « Joyce se nomme artiste, il se met en face de la nature ». Le parlêtre s’ajoute comme trou à la nature. Il fait trou dans la nature, en tant qu’il est parlant et qu’il la nomme. Ni le parlêtre, ni la nature ne sont naturels, puisqu’il y a la nomination. Les conséquences en sont que, pour l’être parlant la nature n’est plus naturelle.
Nous avons poursuivi, ensuite notre lecture du livre d’E. Laurent. Pour Joyce, à la place du texte absent, il y a l’art qui permet de produire le rapport « au manque central de son inconscient3 ». Chez Joyce, il n’y a pas l’hypothèse de l’inconscient freudien, c’est-à-dire qu’il n’y a pas le Nom-du-Père mais, par contre, il y a l’escabeau, l’orgueil, l’art-gueil. Il a de son art, art-gueil « jusqu’à plus soif4 ». Lacan en déduit qu’« il Joyce trop ». C’est-à-dire qu’il jouit trop de l’escabeau pour être un saint. Il jouit de son vouloir dire qui est, par son art, de constituer ce que Joyce a appelé « la conscience incréée de sa race5 » . C’est-à-dire que ça ne passe pas par le Nom-du-Père.
Lorsque E. Laurent écrit que « Le saint est le rebut de la jouissance reconnue par le discours dont il procède et où il vient en position d’objet a6 », il aborde là, la position de déchet, mais par une voie qui est à chaque fois singulière.
Il a ensuite été question de la notion de l’escabeau et de celle de scabeaustration. « Le psychanalyste[…] monté sur l’escabeau […] il n’y a pas moins scabeaustration : quand il opère, il ne jouit pas – contrairement à l’analysant qui jouit de la parole à plein pot7. » L’escabeau, c’est la jouissance de la parole, du sens-joui. C’est la position par rapport au dispositif analytique, où l’on vient pour parler, où on est engagé à le faire et donc on jouit de cette parole, on jouit du sens, on associe autour, … C’est le travail de l’analyse. Le passage à l’analyste implique que la jouissance phallique se sépare, qu’il y a un assèchement du désir. Ce désir qui circule entre les signifiants, qui renvoie aux significations qui en produisent d’autres etc, s’assèche, se dégonfle. Le passage à l’analyste, est un autre type de castration. Ce n’est pas la castration ressentie comme quelque chose de désagréable, d’insupportable d’une blessure narcissique, mais là, elle est consentie. Donc, là où il y avait l’escabeau, ça se sépare et c’est cela qui permet le passage à l’analyste, où il y a retrouvaille avec la dimension de la position analysante, mais à l’endroit de la cause analytique et donc de l’École.
Alexia Lefebvre-Hautot
Notes :
1 Laurent E., L’envers de la biopolitique, éd.Navarin, Le champ Freudien, p. 147.
2 Lacan J., Séminaire livre XXIII, Le sinthome, pages 12-13.
3 Laurent E., op.cit., p. 150.
4 Ibid., p.151.
5 Ibid., p.150.
6 Ibid., p.154.
7 Ibid., p.153
![]() Jeudi 12 janvier
Jeudi 12 janvier
Nous poursuivrons l’étude du livre d’E. Laurent, à partir de la page 154, « La voie de la farce »
Lors de cette séance de travail, nous avons poursuivi la lecture du livre d’E. Laurent, L’envers de la biopolitique, des pages 154 à 161.
Cela nous a donné l’occasion d’éclairer la question de « la farce », qui se présente comme une énigme à déchiffrer et se révèle à partir du rire. Farce dont on peut dire qu’elle montre un certain maniement de la lettre – « qui n’est plus une lettre en souffrance1 ». E. Laurent indique qu’ « il s’agit de la preuve par le rire que le particulier d’une femme est visé par la farce de la lettre […] La farce est énigme, pas message – le rire indique qu’elle est reçue comme telle2 ». Bloom3 use d’un pseudonyme, « Henry Flower », « Flower » impliquant une féminisation permettant davantage le rire. Il y a un destinataire, qui est une femme et elle en rit. Voilà le point essentiel dans la farce c’est que, cette femme qui en rit, fait surgir l’au-delà du phallus et le saint comme objet, de part la féminisation. Bloom est du côté de l’objet, à partir de la féminisation, et non pas du phallus.
La poursuite du texte nous a permis de nous arrêter sur la question de la plus-value, dont Lacan fait usage dans une dimension de quelque chose qui est soutiré. E. Laurent donne l’exemple des frères mendiants qui font payer leur subsistance à un autre. A contrario, Marx fait de la plus-value, la caractéristique économique du capitalisme, à savoir : un rapport économique de classe.
Il faut distinguer l’usage fait par Lacan de cette homologie où il aborde l’objet a comme ce qui est extrait du rapport entre S1 et S2, en tant que chaîne, ayant pour effet un sujet et comme production la plus-value. La plus-value est une extraction, ce qui représente la structure du discours du maître, du discours de l’inconscient. Le sujet est un pur effet de la chaîne et n’est pas actif, d’où les identifications et tout ce qui relève du côté symbolique et imaginaire. D’un autre côté, se trouve l’objet a, qui est en place de ce qui est produit de cette articulation. En aucun cas, la machine symbolique n’aura accès à cet objet qui est produit. C’est le discours de l’inconscient. C’est la structure désignée et généralisée par Lacan, là où Marx en fait une affaire de rapport économique de deux classes sociales, antagoniques. Une classe veut ponctionner plus de profit afin de dégager de la plus-value. Mais, il y a un réel, lié à l’autre classe qui passe son temps à s’opposer à ça. Là où Marx en fait une affaire économique, Lacan l’étend à l’économie de l’inconscient. Il en fait une affaire de jouissance, et il généralise cette plus-value, qu’il appelle l’objet a, qui est une homologie. Il prend le modèle que Marx a inventé, pour l’appliquer à l’inconscient analytique.
Dans ce rapport économique selon le modèle marxien, l’argent qui est extrait, cette plus-value n’est plus en position de déchet, mais est valorisé. Bloom, publicitaire, dévoie la cause de l’objet déchet. Cela fait dire à Lacan que ce n’est « pas cher » et ce, par rapport au statut de l’objet dans le discours analytique. C’est là que s’oppose la question du marché et la question de la dîme prélevée sur les autres. La dîme que les moines mendiants prélèvent et peut-être aussi le psychanalyste, puisque E. Laurent y voit une « sortie du discours capitaliste », formule que Lacan propose dans « Télévision ». Quelque chose du discours de l’analyste ne rentrerait pas dans la question du marché, et en serait même une sortie. Faute de quoi, la psychanalyse ne serait plus un discours, mais inscrite dans une méthode psychothérapique parmi d’autres.
Alexia Lefebvre-Hautot
Notes :
1 Laurent E., L’envers de la biopolitique, éd.Navarin, Le champ Freudien, p. 152.
2 Ibid., p. 157.
3 Joyce J., Ulysse, Trad. et éd. s/dir. J.Aubert, Paris, Gallimard, Coll. Folio classique, 2004, 2013
![]() Jeudi 2 mars
Jeudi 2 mars
Nous poursuivrons l’étude du livre d’E. Laurent, à partir de la page 162.
Lors de cette soirée, nous avons fait une lecture de la leçon du 1er juin 2005, tirée du cours de Jacques Alain Miller, « Pièces détachées », citée dans le livre d’E. Laurent1, que nous souhaitions éclaircir. Cela concerne la dimension « avoir un corps », « la relation à l’autre corps » et la question de la nature du lien à l’autre corps, pour le parlêtre.
S’il est possible en parlant, d’émouvoir ou de séduire un autre corps, il n’est cependant pas possible de le faire sien. Cela indique qu’entre le sujet et l’autre corps, il y a la jouissance. Autrement dit, même en passant par le corps d’un autre, le sujet est toujours en rapport à sa propre jouissance, où le rapport passe par la pensée, le songe, le rêve.
Dans cette leçon du premier juin, E. Laurent prend son point d’appui sur les écrits de Judith Butler qui critique la notion d’identité féminine, dans un processus de lecture sans limite.
Il fait valoir comment Lacan, à partir de Encore et de « L’étourdit », aborde la question de la fonction paternelle, non plus à partir de la métaphore, ou de la question du nom, ou de la maternité, mais à partir de l’écriture logique des formules de la sexuation. Il montre comment, côté homme, Lacan introduit le père comme limite, inscrivant l’impossibilité du rapport sexuel. Ainsi, côté homme, ce qui existe c’est le point de limite, abordé comme un interdit de l’objet maternel. Côté femme, il n’y a pas ce point, d’exception, ce qui ne veut pas dire que l’expérience de jouissance est illimitée. Mais, à l’horizon de la jouissance féminine, il y a l’amour du père, fonction divine dont parle Lacan dans le Séminaire XX quand il dit que « la femme a rapport avec dieu, avec cet Autre barré ». Il faut donc qu’elle en passe par le partenaire, qui doit être un « mi-dieu ».
Le travail effectué par E. Laurent concernant la fonction paternelle, tourne autour de la question d’une fonction qui marque une limite, permettant que s’inscrive, pour une femme, le signifiant maître . Ce n’est donc pas un principe de lecture infinie de la jouissance féminine, qui est à faire valoir dans une analyse ; c’est au un par un.
Dans son premier enseignement, Lacan indique que le Nom-du-Père assure « la consistance de l’Autre ». En effet, dans « la question préliminaire », il présente un Autre consistant, incluant son propre signifiant – le Nom-du-Père, le père de la loi. Mais, assez rapidement, notamment à partir du Séminaire VI, il met l’accent sur le fait qu’« il n’y a pas d’Autre de l’Autre », précisant que l’analyste a à se situer du côté de l’inconsistance et non pas du côté du Nom-du-Père.
Dans la leçon, à la suite de l’intervention d’E. Laurent, se trouve un dialogue avec Jacques Alain Miller, où ce dernier fait valoir la substitution de l’identification à l’identité. Toutes ces identifications relèvent du semblant et cette déconstruction sans fin, fait surgir pour les analystes lacaniens, l’invention du concept du réel. C’est ce qui manque dans les études de genre, pour lesquelles il n’y a pas de limite au processus de l’identification généralisée, toujours du registre du possible pour elles, alors que dans la perspective de l’orientation lacanienne, il y a du réel. Cette fonction vient « suppléer au rapport sexuel » qui lui est impossible, qui ne peut pas s’inscrire dans le symbolique : « ce réel comme impossible a une limite ».
Jacques Alain Miller rappelle la formule de Lacan, selon laquelle « il n’y a pas de rapport sexuel » et c’est un pas de plus que de dire « il n’y a pas d’identité sexuelle ». Lacan avait lui-même « touché à l’identité sexuelle en disant que La femme n’existe pas et qu’il n’y a que du une par une. Il ne peut pas y avoir de généralisation ».
Arrivant à la citation qui nous occupe, dans le livre L’envers de la biopolitique, E. Laurent, interroge : « qu’est-ce que Lacan choisit comme élément minimal de référence ? ». Avant on avait le sujet comme fonction du signifiant et à partir du séminaire Le Sinthome, il propose de prendre comme élément minimal, la consistance qui serait l’opposée de la fonction S barré, fonction variable. « La consistance minimale, ce n’est pas le nœud lui-même, c’est la corde. C’est là que Lacan trouve le Un qu’il avait trouvé jusqu’alors dans le signifiant, il le trouve dans cet élément [de consistance, de corde] » où le nœud est déjà une construction par rapport à cet élément minimum. C’est une fabrication, c’est le résultat d’un faire, donc en ce sens, c’est un « artifice ».
Ainsi, la « consistance première », n’est pas le sujet du signifiant (comme Lacan en parlait avant le séminaire Encore) mais le corps, dont Lacan dit que « le corps est la seule consistance du parlêtre ». Il s’agit là du corps qui se jouit. Cela vient s’opposer au point de vue métonymique, dans les universités américaines, à partir des études de genre, par les féministes.
Au début du séminaire XX, Lacan explique que le fondement de son enseignement c’est la différence entre le langage et l’être parlant. Le parlêtre étant autre chose que la structure du langage. Donc ce n’est pas la structure du symbolique qui fait tenir ensemble la structure langagière, mais ça ne suffit pas à faire tenir ensemble le parlêtre.
La consistance « repose sur un rapport du parlêtre à son corps, qui est un rapport au nœud ». Ce qui est notable, c’est qu’ici « le rapport que Lacan a perdu au niveau sexuel, c’est-à-dire l’inexistence au niveau sexuel, il le retrouve au niveau corporel et d’une certaine façon Joyce sert d’exemple à : il y a un rapport corporel ». C’est-à-dire qu’il y a un rapport du parlêtre à son corps. Il y a un rapport corporel.
Page 161 du livre, Laurent E. fait valoir, que c’est par la pensée et le songe qu’il y a rapport du parlêtre à un autre corps. Le premier rapport d’adoration reste un rapport d’avoir alors que l’Autre (moïsation) est un rapport d’être. Lacan indique que l’idée de soi comme corps pose problème chez Joyce et qu’il faut là une opération, pour rabouter un ego, qui serait une sorte de moïsation du corps propre. Du côté pensée, on peut mettre le sexuel, le sens et l’adoration de l’autre corps. Et du côté de la mentalité, on met la question du corps propre, le stade du miroir, l’amour propre. Joyce a un rapport à son corps qui ne relève pas de la mentalité. Il n’a pas de corps, mais il a une idée de lui comme corps via son ego, qui vient corriger une erreur d’écriture.
Alexia Lefebvre-Hautot
Note :
1 Laurent E., L’envers de la biopolitique, éd.Navarin, Le champ Freudien, p. 161.
![]() Jeudi 30 mars
Jeudi 30 mars
Nous poursuivrons l’étude du livre d’E. Laurent.
Lors de cette séance, nous avons poursuivi, pas à pas, la lecture du livre d’E. Laurent. Nous avons déplié cette phrase : « une certaine aise dans le rapport à la jouissance de l’escabeau1 » et avons admis que la détermination de Joyce, à devenir l’écrivain qui détruit les écrivains, la littérature et dont on va s’occuper, pendant 300 ans, à l’université, est ce qui représente son escabeau. Dans son rapport à cette jouissance, il se tient à distance du symbole et, son épopée du corps, son escabeau est celui de l’obscénité, avec laquelle il est à l’aise, parce qu’à distance des idéaux. Cette obscénité du corps est mise au centre de son écriture. Nous ne savons pas ce qu’est cette jouissance opaque et ininterprétable, mais elle se trouve dans le texte. Si c’est un symptôme, cette jouissance ne peut pas avoir une signification ; elle est hors sens, c’est « la seule chose que de son texte nous puissions attraper. Là est le symptôme2 ». C’est le symptôme au sens métonymique et non pas au sens métaphorique. Ce qui est en jeu est raté et aucune signification ne vient à bout de ce point qui reste toujours hors sens.
Poursuivant notre lecture, nous nous sommes arrêtés sur cette citation : « Le rapport de Joyce à l’inconscient existe donc3. » et nous avons interrogé cette affirmation car, même s’il est sûr que Joyce a un rapport aux rêves, cela ne suffit pas à poser ce rapport à l’inconscient comme un état de fait. Pour autant, nous avons considéré cette formule comme point d’appui, en fonction de ce qui précède dans le livre et du contexte dans lequel évoluait Joyce et avons repéré un faisceau d’indices concordants, permettant d’affirmer le rapport de Joyce à l’inconscient. Il y a les livres de psychanalystes qui circulent dans ces années là. Il y a le fait que Joyce a 3 livres de psychanalystes. Il a des conversations avec des personnes importantes (dont un imminent psychanalyste d’Italie). Il y a aussi les rêves de Nora qu’il interprète selon son bon vouloir. C’est donc à partir de tous ces éléments qu’il est possible de considérer qu’il y a un certain rapport à l’inconscient, dont nous ne savons pas bien de quoi il est fait. E. Laurent précise que « c’est une relation en court-circuit ». Il nous a paru important de préciser que de parler de rapport à l’inconscient, qu’il soit ou non désabonné, n’indique pas, pour un sujet, tout de ce rapport.
E. Laurent poursuit en écrivant que Lacan, aborde « l’opposition entre lalangue et langage dans le rapport au symptôme […,] symptôme, en tant que rien ne le rattache à ce qui fait lalangue elle-même dont il supporte cette trame […], Joyce le porte à la puissance du langage, sans que pour autant rien n’en soit analysable. » Pour éclaircir cette phrase, il a été rappelé que, dans « La troisième », J. Lacan précise que lalangue est une langue morte, que le symbole transforme lalangue en bois mort. Il s’agit donc d’une jouissance transformée en bois mort par le symbole. Le symptôme joycien, ne peut être attrapé par le symbolique, et ne se rattache pas à ce qui fait lalangue. Pour préciser la dimension de la trame, nous nous sommes référés à la métaphore de la trame du tissu : il faut la trame et il faut les fils de chaîne, sinon ça ne marche pas. Joyce, lui, a affaire à la trame du tissu (c’est lalangue). Les névrosés ont affaire au tissu. Si nous restons marqués par le tissu, nous n’y comprenons rien à la trame. C’est-à-dire que la trame reste hors sens, hors la représentation du tissu. La trame est ce qui fait le tissu. Lacan, dans son premier enseignement, mettait l’accent sur le tissu. Là, il met l’accent sur la trame, que le tissu ne permet pas de toucher. En effet, le langage, en tant que pourvoyeur de sens, ne permet pas de toucher cette trame. Le symptôme, c’est l’idée que la trame ne peut être ni définie, ni signifiée, à partir du langage. « Met him pike hoses » est du ressort de la trame et c’est ce que Lacan appelle le symptôme comme « porté à la puissance du langage », « en se passant du père », pour Joyce. De fait, ici, la place que la lalangue occupe, a la même fonction que le langage, mais sans les artifices et la matrice qui comporte le nom du père, en tant qu’il l’organise.
A propos de l’extrait page 168, un point a été soulevé, concernant l’idée que la sonorité contribue à donner du sens aux phrases. Dans ces dernières, quand nous prenons le terme employé, nous n’y comprenons rien. Mais quand nous le lisons à haute voix, la dimension double s’entend, ce à quoi nous avons toujours affaire mais dans la dimension qui est le hors sens. Il y a là des décompositions phonétiques4 eaub jeddard ou métempsychose, faites de sonorités, ne renvoyant à aucune signification, donnant un sentiment d’étrangeté à leur lecture et faisant échec à toute recherche de sens. Ces décompositions se présentent comme du langage dont la fonction serait de détruire toute relation entre le signifiant et la signification. Cela devient une écriture, dont l’intérêt n’est pas de lire, mais porte sur ce qui s’écrit. Par exemple, « Met him pike hoses », donne métempsychose. Il ne s’agit pas là du sens mais du son. Ne pas en passer par la vocalise, nous fait passer à côté de la décomposition sonore et donc, à côté de l’opération qu’il fait et qui est ininterprétable. Il s’agit là de la différence entre sens joui et jouissance, qui ne peut s’attraper qu’en faisant abstraction du sens. C’est de ça dont il s’agit dans une analyse : ce balancement entre sens et hors sens. Il y a l’idée de vouloir comprendre, puis la question que le praticien a à se poser : Qu’est-ce qu’on habite d’une interprétation ? En prononçant des paroles, nous pouvons entendre, à partir d’une sonorité, un sens, une signification. Mais, une analyse amène à l’étrange. Et, c’est préférable. Pour Joyce, il s’agit de s’intéresser à ce qui s’écrit et d’accepter le fait de ne pas comprendre, puisque c’est de cette logique dont il s’agit, et c’est porté à la dignité du symptôme. Chez Joyce, ce qui est du ressort de la lalangue est utilisé comme un langage.
Ainsi, ce que développe E. Laurent à propos de Lacan lecteur de Joyce, c’est qu’il s’agit de se débarrasser de la bonne façon du sens. Pour qu’une analyse ait lieu et puisse se conclure, il faut faire cette opération qui ne consiste plus à lire. Jacques-Alain Miller5 indique que l’opération analytique ne s’arrête pas à la lecture, c’est-à-dire au fait de décomposer les éléments, de se les expliquer pour arriver à la racine. Une fois que nous y sommes, ce n’est pas fini et, il y a à s’en débrouiller. C’est à cet endroit que l’opération de ce qui s’écrit et de ce que nous en faisons, commence. Dans son premier enseignement, Lacan indiquait que l’ultime de l’analyse, se produisait grâce au langage, réduisant la jouissance. Là, il apporte des éléments venant contredire point à point ce qu’il a dit précédemment.
Alexia Lefebvre-Hautot
Notes :
1 Laurent E., L’envers de la biopolitique, éd.Navarin, Le champ Freudien, p. 165.
2 Laurent E., op.cit., p.167.
3 Laurent E., op.cit
4 Laurent E., op.cit., p.168.
1 Miller J.-A., L’os d’une cure, éd.Navarin, Le champ Freudien,
![]() Jeudi 4 mai
Jeudi 4 mai
Nous poursuivrons l’étude du livre d’E. Laurent. Marie-Hélène Doguet Dziomba nous propose de travailler la question du temps logique.
![]() Jeudi 8 juin
Jeudi 8 juin
Nous poursuivrons l’étude du livre d’E. Laurent.
Le 4 mai 2023 nous nous retrouvions avec les membres du groupe Studiolo pour examiner la page 167 du livre d’Éric Laurent - L’envers de la biopolitique - une écriture pour la jouissance1.
Marie-Hélène Doguet Dziomba nous amène des références concernant ”l’assertion de certitude anticipée” extraite de la question du temps logique, en vue de différencier le rapport de Joyce à l’inconscient2.
Elle nous propose de plonger dans une référence du séminaire 23 de Jacques Lacan, le chapitre : “Où est la parole ? où est le langage ?” (séance du 15 juin 1955). Il s’agit du début de l’enseignement de Lacan, il n’y a donc pas à ce moment de références à l’objet a de Lacan. Lacan dégage trois points dans la partie 3 de cette séance, il évoque cet apologue, ce sophisme (l’argument est faux malgré une apparence de vérité) et les différentes dimensions du temps, plusieurs, trois dimensions temporelles.
Extrait du Séminaire 2 (séance du 15 juin 1955) – partie 3 4 :
« Je vais prendre un autre apologue, peut-être plus clair que celui de Wells, parce qu’il a été fait exprès dans l’intention de distinguer l’imaginaire et le symbolique. Il est de moi.
Ce sont trois prisonniers qu’on soumet à une épreuve. On va libérer l’un d’entre eux, on ne sait pas lequel faire bénéficier de cette grâce unique, car tous les trois sont aussi méritants. On leur dit- Voilà trois disques blancs et deux noirs. On va attacher à chacun de vous un quelconque de ces disques dans le dos, et vous allez vous débrouiller pour nous dire lequel on vous a flanqué. Naturellement, il n’y a pas de glace, et ce n’est pas de votre intérêt de communiquer, puisqu’il suffit de révéler à l’un ce qu’il a dans le dos pour que ce soit lui qui en profite.
Ils ont donc chacun dans le dos un disque. Chacun ne voit que la façon dont les deux autres sont connotés par le moyen de ces disques.
On leur met à chacun un disque blanc. Comment chaque sujet va-t-il raisonner ?
Cette histoire permet de montrer des étagements, des dimensions, comme disait tout à l’heure Perrier, du temps. Il y a trois dimensions temporelles, ce qui mérite d’être noté, car elles n’ont jamais été vraiment distinguées. Il n’est pas invraisemblable qu’ils se rendent compte très vite tous les trois qu’ils ont des disques blancs. Mais si on veut le discursiver, ce sera obligatoirement de la façon suivante. Il y a une donnée fondamentale qui est de l’ordre des 0 et des petits 1 - si l’un voyait sur le dos des autres deux disques noirs, il n’aurait aucune espèce de doute, puisqu’il n’y a que deux noirs, et il pourrait s’en aller. Ceci est la donnée de logique éternelle, et sa saisie est parfaitement instantanée - il suffit de voir. Seulement voilà, aucun d’eux ne voit deux disques noirs, et pour une bonne raison, c’est qu’il n’y a pas de disque noir du tout. Chacun ne voit que deux disques blancs.
Néanmoins, cette chose qu’on ne voit pas joue un rôle décisif dans la spéculation par où les personnages peuvent faire le pas vers la sortie.
Voyant deux disques blancs, chaque sujet doit se dire qu’un des deux autres doit voir ou bien deux disques blancs ou bien un blanc et un noir. Il s’agit bien de ce que chacun des sujets pense ce que doivent penser les deux autres, et d’une façon absolument réciproque. Une chose est certaine, en effet, pour chacun des sujets, c’est que les deux autres voient chacun la même chose, soit un blanc et sa propre couleur à lui, le sujet, qui ne la connaît pas.
Le sujet se dit donc que, si lui-même est noir, chacun des deux autres voit un blanc et un noir, et peut se dire - Si je suis noir, le blanc aurait déjà pris la voie vers la sortie, et puisqu’il ne bouge pas, c’est que je suis blanc moi aussi, et je sors.
Or, comme notre tiers sujet ne voit sortir aucun des deux autres, il en conclut qu’il est blanc, et il sort. C’est ainsi, du fait de l’immobilité des autres, que lui-même saisit qu’il est dans une position strictement équivalente aux deux autres, c’est-à-dire qu’il est blanc. Ce n’est donc que dans un troisième temps par rapport à une spéculation sur la réciprocité des sujets, qu’il peut arriver au sentiment qu’il est dans la même position que les deux autres.
Néanmoins, observez que, dès qu’il est arrivé à cette compréhension, il doit précipiter son mouvement. En effet, à partir du moment où il est arrivé à cette compréhension, il doit concevoir que chacun des autres a pu arriver au même résultat. Donc, s’il leur laisse prendre tant soit peu d’avance, il retombera dans son incertitude du temps d’avant. C’est de sa hâte même que dépend qu’il ne soit pas dans l’erreur.
[…]
C’est un sophisme, vous vous rendez bien compte, et l’argument se retourne au troisième temps. Tout dépend de quelque chose d’insaisissable. Le sujet tient dans la main l’articulation même par où la vérité qu’il dégage n’est pas séparable de l’action même qui en témoigne. Si cette action retarde d’un seul instant, il sait du même coup qu’il sera plongé dans l’erreur. »
Le langage est différent de la parole ; de l’utilisation du langage telle une suite de 0,1, 0,1 (langage machine), le prisonnier pourra déduire vite et alors sortir. La question sur cette suite est là, c’est la question des trois prisonniers et de celui qui ne porte pas de disque noir. Le premier temps se voit, mais le rôle décisif est celui de “ce qui ne se voit pas”, le temps dit spéculatif. La hâte, le moment de conclure l’acte est là où est la parole, c’est un moment décisif, la scansion temporelle.
Revenons sur 3 temps : 1/ l’instant de voir qui lie langage et image, 2/ temps pour comprendre entre langage et image, 3/ temps pour conclure qui est de l’ordre du symbolique. La troisième dimension du temps n’appartient pas à ces deux machines : ni retard, ni avance mais la hâte qui va lier qui est là en termes de liaison de l’être humain au temps, le temps qui le pousse où se situe la parole.
Pourquoi n’arrive-t-on à rien avec le langage ? (concerne l’idée de vérité et de paroles comme scansion temporelle). Le temps et la jouissance c’est tout à fait différent à aborder avec l’objet a.
La parole et le langage
![]() le langage ne pousse pas, pas de dimension de la hâte, le comble du langage, la machine
le langage ne pousse pas, pas de dimension de la hâte, le comble du langage, la machine
![]() la parole soulève la question du sens et de la signification
la parole soulève la question du sens et de la signification
Nous revenons au séminaire 2 : aucune signification dans le langage machine ça circule, c’est la machine universelle qui tourne. Et quand on arrête la machine, c’est la coupure temporelle, ça donne du sens.
Notons le progrès historique de la subjectivité retrouvée dans la parole analysante ; c’est un langage historiquement incarné, celui d’une communauté de langage. C’est la machine ordonnée avec ses lois propres, on y entre par contrainte, par usage de métaphore et métonymie.
Serge Dziomba commente le séminaire 2 : la parole échappe serait donc du côté de la hâte, la capacité de la parole c’est l’intervention de la scansion dans le langage - c’est très différent de la parole jouissante.
Donc revenons au commentaire du séminaire II : le premier temps de Lacan, capacité opératoire de la parole à partir du sujet, la parole découpe le temps ; quand la parole devient jouissance elle n’est plus déterminante sous cet angle là ce qui fait étonnement : c’ est surprenant et intéressant dans ce séminaire 2 c’est que la question de la hâte anticipe déjà la passe. Devant la question de cette certitude anticipée quand ce prisonnier voit du blanc sur le dos de l’autre, il s’ensuit un acte, il y va : cet acte de partir de sortir de la prison c’est une certitude là indémontrable, ce qui ne se mesure qu’après la sortie ; quelque chose a changé, c’est la question logique de la passe. Cet éprouvé de la certitude va conduire et nommer un acte singulier ; ce qui peut bloquer cela c’est le langage ; l’appareil langagier dans un ensemble clos contient l’ensemble de l’histoire commune qui va de l’universel au particulier. Là, la dimension historique, le discours concret nommé par Lacan, c’est la dimension universelle où le langage est une machine modèle cybernétique comme un moteur à vapeur Hegel ne connaissait pas le moteur à vapeur, il voyait la totalité comme universelle. Ce qui est premier dans le langage est le nombre, ce sont des 0 et des 1, toujours premiers, la parole se situant en extériorité au langage, on peut couper dans le disque de l’histoire.
Dans le séminaire Encore5, la parole non déliée de jouissance c’est la dévalorisation de la parole qui est première (indispensable dans une cure), mais à la fin d’une analyse, pouvoir accorder aux significations qu’elle produit le moins de valeur possible.
Marie-Hélène Doguet Dziomba : « oui il s’agit d’extraire les petits zéros et les petits uns afin de produire une écriture ».
Serge Dziomba fait l’annonce de la première séance du séminaire interne (31 mai) où seront abordés les paradoxes de la passe et la logique de la procédure de la passe.
Par contre notons la différence : on ne retrouve pas chez Joyce de coupure temporelle, c’est d’un autre registre que l’on parle, ce que Joyce n’en voit pas c’est la logique qu’elle détermine.
La scansion dont on fait l’usage dans la parole débouche sur une autre signification ; cette coupure temporelle arrête la machine temporelle et fait surgir la signification et le sens.
Dans le cas de Joyce il s’agit là de court-circuit : on pourrait dire que ça fait “sauter les plombs” ; il introduit au chaos. Lacan va changer son fusil d’épaule à ce moment de son enseignement pour intervenir autrement sur le langage (machines et histoire). Ici Joyce est hors du champ de la parole ça ne l’intéresse pas6. Il figure ce rapport d’opposition entre lalangue et le langage, langage élucubration sur la lalangue, langage est une strate (tissu) ; sous le langage il y a lalangue (en un mot = trame), langage pour tenter d’ordonner ce qui n’est pas en ordre dans la lalangue, qui n’a pas de sens. Le Symptôme7 pour Joyce : “le symptôme, en tant que rien ne le rattache à ce qui fait lalangue elle-même dont il supporte cette trame[…]Joyce le porte à la puissance du langage, sans que pour autant rien n’en soit analysable”. Nous sommes là dans le hors-sens des significations sans articulation ; des « 1 » se juxtaposent : cette lalangue n’est pas la langue familiale, c’est le bruit de la lalangue commune, il n’en a que la trame - comme évoqué lors de la précédente séance.
Le symptôme porté à la puissance du langage8 il le porte à la puissance de la littérature, nous dirons que le symptôme chez Joyce a deux faces : en premier jouissance, en second signifiable mais il n’en n’est pas analysable pour autant.
Le symptôme supporte cette trame de lalangue, le symptôme n’est pas rattaché à ce qui fait lalangue elle-même : il y a une séparation radicale entre le symptôme et la lalangue . L’utilisation du mot jouasse symptôme toute jouissance non dicible, elle exerce une certaine fascination et porte cela à la puissance du langage.
Du symptôme lié à la jouissance dans le texte, on voit, on sent cette présence de la jouissance dans le texte : c’est le symptôme de Joyce, cette présence de la jouissance dans son texte qu’il écrit, Joyce le porte à la puissance du symptôme9.
Nous relisons le début de la page 168 du livre d’Eric Laurent10. Dans cette lecture de la première phrase, il nous faut distinguer les homophonies sonores, des équivoques de la lalangue de l’inconscient. L’écriture de Joyce semble se rapprocher de la manie, c’est par sa forme métonymique, la sonorité a toute son importance. Là pas d’équivoque de la langue de l’inconscient pour lui la question du père, (pourspère) c’est le bazar : il tente d’en faire quelque chose11.
Martine Desmares
Notes :
1 Laurent E., L’envers de la biopolitique - une écriture pour la jouissance, Navarin Le Champ freudien, 2016
2 Ibid., p 167
3 Lacan J., Le Séminaire, Livre II, Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse, Seuil
4 Ibid.
5 Lacan J., Le séminaire, Livre XX, Encore, Seuil
6 Laurent E., L’envers de la biopolitique - une écriture pour la jouissance, op.cit., fin de la page167
7 Lacan J. “Joyce le Symptôme”(1976), Autres écrits, Paris, Seuil
8 Laurent E., L’envers de la biopolitique - une écriture pour la jouissance, op.cit., p.168
9 Ibid.
10 Ibid.
11 Ibid., p 170-171
![]() Jeudi 29 juin
Jeudi 29 juin
Nous poursuivrons l’étude du livre d’E. Laurent.
Studiolo
Le jeudi 17 novembre, ANNULÉ et reporté au mercredi 7 décembre, les jeudis 12 janvier, 2 mars, 30 mars, 4 mai, 8 juin, 29 juin à 21h en visioconférence ZOOM
Un lien Zoom est adressé aux participants avant chaque séance.
Participation aux frais : 5 € par soirée ou 25 € pour l’année et pour l’ensemble des activités et séminaires proposés par l’ACF-Normandie. Réduction de 50 % pour les étudiants.
Responsable et contact : Alexia Lefebvre Hautot
Pour contacter la responsable : envoyer un mail
Revenir à L’ACF-Normandie » ou à l’Accueil du site ».
Accéder à l’Agenda ».