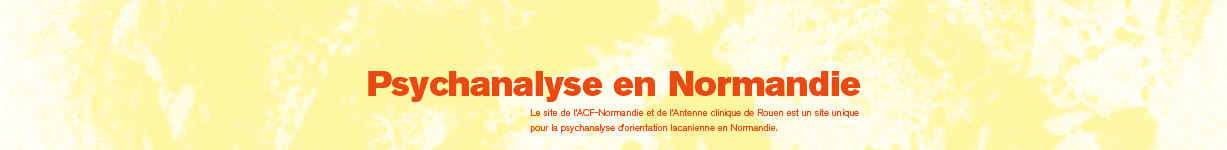ACF-NORMANDIE

- Présentation de l’ACF
-
Séminaires de l’ACF et activités des membres
- - ACF 2022-23 : les archives.
- - ACF 2021-22 : les archives.
- - ACF 2020-21 : les archives.
- - ACF 2019-20 : les archives
- - ACF 2018-19 : les archives
- - ACF 2017-18 : les archives
- - ACF 2016-17 : les archives
- - ACF 2015-16 : les archives
- - ACF 2014-15 : les archives
- - ACF 2013-14 : les archives
- - ACF 2012-13 : les archives
- - ACF 2011-12 : les archives
- - ACF 2010-11 : les archives
- Cartels de l’ECF
Recherche
Par activités
- Activités ROUEN
- Activités LE HAVRE
- Activités EURE
- Activités CAEN
- Activités CHERBOURG
- Rouen archives
- Le Havre archives
- Eure archives
- Caen archives
- Cherbourg archives
- À ÉCOUTER
- AUTISME
Publié le lundi 31 octobre 2022
Séminaire Janus « Lacan pour tous » – 2022-23 – Rouen
Alpha plus Bêta, un lieu pour parler de la théorie : « Qu’est-ce qui agite les corps parlants ? »
Les mercredis 18 janvier, 8 février, 29 mars, 12 avril, 24 mai, 21 juin 2023 -20h30

Le Séminaire Janus comporte Alpha plus Bêta : un lieu pour parler de la théorie et Schmilblick, un lieu pour parler des pratiques. Alpha plus Bêta et Schmilblick ne sont pas symétriques l’un de l’autre...
La théorie psychanalytique ne constitue pas un ensemble fermé, un tout dogmatique, mais au contraire un ensemble ouvert (sans totalité), toujours remanié par l’opacité ou le réel qui aimante la pratique. L’enseignement de Lacan est radical parce qu’il met la faille entre théorie et pratique1 au cœur de l’élaboration de l’expérience analytique – cette faille traverse la théorie elle-même, qu’on la nomme sujet, manque, trou, objet a, jouissance etc. Au fond cette faille est liée à l’incidence du langage en tant que tel, elle est liée à l’impact du signifiant sur les corps parlants et les développements logiques qui en sont la conséquence.
Voilà le point de départ de la pratique et de la théorie psychanalytiques. Parler de logique signifiante vient déplacer la question des rapports entre théorie et pratique ; elle nous met sur la piste de la lecture et de l’écriture. Qu’est-ce qui se lit dans une pratique ? Qu’est-ce qui peut s’en écrire ? Quels sont les liens entre la lecture et l’écriture ? Entre l’opacité et le sens ? C’est à partir de la parole et du signifiant qu’une pratique qui a pour boussole la psychanalyse peut opérer, avec l’éthique du bien-dire, même si le praticien s’oriente, lui, à partir de ce qui résiste au sens, de ce qui fait opacité.
Nous vous proposons de venir parler de théorie à partir de ce point de départ. Pour cela, chaque soirée sera animée par un binôme. L’un aura écrit le texte d’un cas ou d’une situation issue de sa pratique, l’autre l’aura lu et de sa lecture découlera un premier travail en commun ; ils nous en livreront le résultat qui mettra en exergue les concepts permettant une lecture du cas ; ceci rendra possible une conversation autour de toutes ces élucubrations.
Alpha plus Bêta s’adresse à tous ceux qui sont taraudés par leur pratique et la tentative de l’éclairer, d’en rendre compte, et plus particulièrement aux jeunes praticiens, et aux moins jeunes ! Alpha plus Bêta s’adresse aussi aux étudiants et à tous ceux qui s’intéressent à l’enseignement de Lacan, et se demandent comment… le lire !
Le Séminaire Janus comporte, outre Alpha plus Bêta, Schmilblick , un lieu pour parler des pratiques, qui n’a pas lieu le même jour. Schmilblick n’est pas symétrique d’Alpha plus Bêta ; tous ceux qui participent à Schmilblick sont invités à venir à Alpha plus Bêta, l’inverse n’est pas proscrit mais n’est pas prescrit non plus ! A chacun de faire selon son goût !
Marie-Hélène Doguet-Dziomba
Note :
1 Notre époque psy, celle du DSM, se veut « athéorique », aspirant à dissoudre le champ de la clinique dans des listes syndromiques sous la férule des « preuves scientifiques » souvent assimilées à des chiffres voire des algorithmes. Ces listes « athéoriques » sont d’une autre nature que ce que Lacan appelait « l’enveloppe formelle du symptôme », elles sont déconnectées du réel de chaque patient, et méconnaissent la logique signifiante qui donne son armature structurale à chaque cas. Elles laissent de côté le rapport complexe entre théorie et pratique. Car une pratique est toujours sous-tendue par une théorie qui n’a pas besoin d’être éclairée pour avoir des effets ; et une pratique s’inscrit toujours dans un discours qui lui donne son cadre ; quant à la théorie d’une pratique, elle suppose toujours un certain usage du concept, un « mésusage » selon Lacan, si l’on considère que jamais un concept n’abolira le réel en jeu dans la pratique.
Nous allons poursuivre le Séminaire cette année en gardant notre formule : un texte présenté par un praticien d’orientation lacanienne, travaillé en amont et en binôme avec un « lecteur », pour en extraire une première étude nouant théorie et pratique. Ce texte sera adressé aux participants avant la séance afin de favoriser la conversation lors de celle-ci.
Pour aider à l’extraction de concepts théorisant la pratique, nous avons choisi comme fil rouge pour l’année le thème suivant : « Qu’est-ce qui agite les corps parlants ? »
L’agitation, « l’hyperactivité », « l’attention » troublée, sont des signifiants épinglant aujourd’hui « l’enfant comportemental » dans sa famille, à l’école ou dans les institutions qui l’accueillent ; mais au-delà, ces signifiants sont le nom d’un malaise contemporain, d’un mode de « zapping », de rapport aux objets et à la temporalité qui engagent le corps des êtres parlants. Ils sont aussi le signe du traitement réservé aujourd’hui aux corps dés lors qu’ils sont ravalés par l’idéologie et le discours neuro-scientiste, au rang d’objets cognitifs standards, échangeables, anonymes et silencieux – c’est-à-dire déconnectés du champ du langage et de la fonction de la parole. C’est là que l’étude de la pratique d’orientation lacanienne s’avère nécessaire et précieuse, car notre point de départ est précisément le corps toujours déjà pris dans les trois dimensions du langage : l’imaginaire, le symbolique et le réel. Pas de corps sans l’incidence du signifiant, pas de corps pour l’être parlant sans l’impact de la langue de l’autre familial, pas de jouissance élaborable sans les circuits de la parole et du langage. Autrement dit toute l’épaisseur de la pratique, de la position prise par le praticien, du lieu qu’il aura pu constituer pour son patient, de ce qu’il aura pu mettre en mouvement à partir de la division du sujet – toute cette sériation se branche sur le nouage (ou pas) entre paroles, corps imaginaire et corps de jouissance. Ce sont ces circuits complexes que nous proposons de mettre à l’étude.
Ce qui agite les corps parlants ne se réduit bien évidemment pas à « l’hyperactivité » et aux désordres de « l’attention ». N’oublions pas la célèbre série freudienne – inhibition, symptôme et angoisse, que Lacan a reprise de bien des manières. L’affect comme incidence du langage sur le corps, l’angoisse signal et index du réel, l’inhibition (du moi imaginaire) ; la pétrification, le gel ou la prise en masse du corps par le signifiant dans son versant de pur impératif ; l’émotion, l’émoi, le passage à l’acte ou l’acting-out, sont autant de pistes à explorer – et ceci n’est pas exhaustif !
Nous vous invitons donc à vous inscrire pour participer à cette enquête !
Marie-Hélène Doguet-Dziomba, responsable du Séminaire
![]() Mercredi 14 décembre ANNULÉ et reporté au mercredi 18 janvier
Mercredi 14 décembre ANNULÉ et reporté au mercredi 18 janvier
Cette soirée sera animée par Alexia Lefebvre-Hautot et Marie-Hélène Doguet-Dziomba.
« L’objet qui agite Mr A., un objet-insatisfaction et raté (de la mauvaise façon) »
Pour cette première séance de l’année, Alexia Lefebvre-Hautot nous présente Mr A. et l’objet qui l’agite tel qu’il se cerne au fil de leurs rencontres. Mr A. est agité par ses pensées, il en est joué et témoigne à son corps défendant que « la pensée est jouissance1 » . Son symptôme se déploie dans un circuit où les compulsions répondent aux compulsions avec un montage fait de défenses. Sa vie amoureuse est marquée par le ravalement de son objet, après avoir arraché à la partenaire une « première fois », la seule qui vaut satisfaction pour lui, son désir est mortifié, en chute, sous le sceau d’une aliénation à la demande de l’autre dans laquelle il s’oublie. Au fil des séances, avançant avec une parole qui tourne en boucle et cherche à s’annuler, Mr A. lâche des bribes de sa construction fantasmatique grâce aux interventions d’Alexia ; on l’entend occuper différentes places dans un scénario implacable et répétitif : dans sa hantise, il est celui qui sera laissé-tombé, jeté, tel Gribouille il est celui qui jettera sa partenaire pour éviter d’être jeté, mais il est aussi celui qui « l’attachera » tout en la jetant, celui qui sera là sans y être, il est celui qui crie et harcèle mais aussi celui qui fait crier et pleurer. Au cœur de ses compulsions, se découvre une fixation à l’exigence maternelle vorace connectée à une insatisfaction ravageante, se découvre aussi la figure paternelle de « l’homme couché ». Dans sa quête impossible qu’il vit sous le mode de l’impuissance, il ne cesse d’éviter et de fuir la jouissance Autre de la mère, « celle qu’il ne faudrait pas2 » , dont il tente de boucher le trou en voulant la combler et la satisfaire en vain. Le chapitre V du Séminaire XX Encore, nous offre des perspectives de lecture pour ce cas : l’objet de Mr A. fait de tous ces méandres de pensées qui agitent le corps de jouissance, est la façon dont Mr A. rate le rapport sexuel qu’il n’y a pas, Mr A. tourne autour du trou sur le mode du « tout » ; son symptôme nous dit que « la jouissance (…) s’il y en avait une autre que la jouissance phallique, il ne faudrait pas que ce soit celle-là », celle de l’autre ou celle de l’Autre comme Autre inatteignable. « Il est faux qu’il y en ait une autre », phrase que Lacan nous fait lire avec l’équivoque entre « faux » et « faut ». Ce n’est pas parce qu’il n’y en a pas et que de ça dépend le « il ne faudrait pas », qu’il n’y a pas « faute » et culpabilité : car « il faut que celle-là soit, faute de l’autre, qui n’est pas » – ajoute Lacan. C’est avec ces formules vertigineuses que nous vous proposons de lire le texte d’Alexia.
Marie-Hélène Doguet-Dziomba
Notes :
1 J. Lacan, Le Séminaire, Livre XX, Encore, p. 66.
2 Ibid., p. 56 et 57
![]() Mercredi 8 février
Mercredi 8 février
NB : Séance en visioconférence uniquement
Cette soirée sera animée par Catherine Grosbois et Serge Dziomba.
Au printemps 2022 Catherine Grosbois rencontre Robert, un enfant de onze ans. Sa mère l’accompagne lors de ce premier entretien. Apparait alors immédiatement l’enfant voulant parler et sa mère qui le protège et qui ne veut pas. Cette première rencontre permet de saisir l’enjeu présent dans l’accueil à l’œuvre lors des premiers rendez-vous. Il s’agit d’un pari où une question se formule : qu’est-ce qui est à entendre dans l’écoute ?
En effet, dans les entretiens du début vont se concentrer les termes de la rencontre et les enjeux qui y sont liés, pas sans la tactique et le tact qu’elle requiert, pas sans la stratégie où la psychanalyse peut opérer. Mais il s’agit toujours d’un pari qui, pour avoir une chance d’advenir, doit être orienté par le discours du psychanalyste, c’est-à-dire s’adresser à l’enfant comme sujet concerné.
Notre étude portera donc sur le serrage de ce qui s’écoute en vue qu’advienne le sujet à entendre.
La mère pourra consentir à laisser la place à la parole de l’enfant comme sujet. Ce résultat est obtenu par une manœuvre qui lui délivre un éprouvé impliquant son corps : elle sait son enfant accueilli comme sujet.
Nous pourrons également nous intéresser à la fonction de l’écriture pour Robert.
Serge Dziomba
Nous nous sommes retrouvés, avec beaucoup de plaisir et dans un échange qui fut très vif, le 8 février 2023, autour du cas de Robert, présenté par Catherine Grosbois. Serge Dziomba, lecteur, nous a proposé des pistes afin d’orienter notre discussion.
![]() Le texte écrit par Catherine, est très riche en enseignement concernant la question de l’accueil de Robert et de sa mère. La mère de Robert annonce que ce dernier a décidé de ne pas parler. Catherine, avec insistance et tact, poursuivra d’un « mais sans doute Robert peut répondre à mes questions ? » Robert ne parle pas mais écrit « OUI » sur le tableau. Point zéro de la première rencontre. Là où Robert amenait sa mère avec lui en séance avec ce propos « je ne parlerai pas, c’est toi qui parleras » l’insistance décidée et le tact dont a fait preuve Catherine, ont ouvert la voie à un « OUI », permettant de sortir du discours commun, du discours des spécialistes que la mère sert dans un premier temps à Catherine. Un deuxième temps va venir marquer l’entrée dans le discours analytique, quand Catherine proposera à la mère de Robert – parlant des tests passés par son fils – que ses « tests [à Catherine] ne sont pas spécialement orientés vers un terme précis mais plutôt destinés à commencer des soins, en cherchant les points d’appuis pour une thérapeutique ». La mère va approuver cela et consentir à ce qu’il y ait cette conversation avec des moyens surprenants entre Catherine et Robert.
Le texte écrit par Catherine, est très riche en enseignement concernant la question de l’accueil de Robert et de sa mère. La mère de Robert annonce que ce dernier a décidé de ne pas parler. Catherine, avec insistance et tact, poursuivra d’un « mais sans doute Robert peut répondre à mes questions ? » Robert ne parle pas mais écrit « OUI » sur le tableau. Point zéro de la première rencontre. Là où Robert amenait sa mère avec lui en séance avec ce propos « je ne parlerai pas, c’est toi qui parleras » l’insistance décidée et le tact dont a fait preuve Catherine, ont ouvert la voie à un « OUI », permettant de sortir du discours commun, du discours des spécialistes que la mère sert dans un premier temps à Catherine. Un deuxième temps va venir marquer l’entrée dans le discours analytique, quand Catherine proposera à la mère de Robert – parlant des tests passés par son fils – que ses « tests [à Catherine] ne sont pas spécialement orientés vers un terme précis mais plutôt destinés à commencer des soins, en cherchant les points d’appuis pour une thérapeutique ». La mère va approuver cela et consentir à ce qu’il y ait cette conversation avec des moyens surprenants entre Catherine et Robert.
Notons que la position maternelle vise à protéger son enfant. Repérant un certain nombre de difficultés chez lui, notamment concernant le lien social, elle en a fait part à Catherine. Cela va permettre à Robert de faire savoir de quoi est constitué son lien social : si, il a des amis, des vrais, ce sont ses doudous, avec une préférence pour certains. Se remarque ici le non-rapport entre le dit de la mère concernant Robert et le dire de Robert. Mme parle et Robert contredit ou précise les choses. Pour que ce soit sans rapport, il faut que ça existe ensemble : l’un ne va pas sans l’autre. Ici, il n’y a pas d’absence.
![]() Cela nous a mené à échanger autour de la dimension des micros dans les cauchemars. La mère de Robert constitue son micro, dans la mesure où c’est elle qui doit parler pour lui. A partir de là, il peut préciser les choses, ce qui le soucie ou l’inscrit dans une certaine dimension sociale. Cela met en exergue la relation complexe qui existe entre sa mère et lui. Relation nécessaire mais aussi cauchemardesque. Constat fut fait qu’il n’y a aucune opposition entre cette mère et son fils. Il s’agirait plutôt d’une relation sans envers ni endroit, comme sur une bande de Moebius où ça circule de façon conjointe, avec nécessité de la présence de la mère. Ici, l’absence symbolique ne figure pas. Ce n’est que présence, présence perpétuelle à laquelle Robert a à faire. La présence de Robert dépend de la présence de sa mère chargée de dire afin qu’il puisse ensuite compléter ou préciser les choses. Pour traiter cette présence sans absence, Robert trouve des débrouilles en se branchant sur le micro et la dimension de la lettre. Cela est vital pour lui.
Cela nous a mené à échanger autour de la dimension des micros dans les cauchemars. La mère de Robert constitue son micro, dans la mesure où c’est elle qui doit parler pour lui. A partir de là, il peut préciser les choses, ce qui le soucie ou l’inscrit dans une certaine dimension sociale. Cela met en exergue la relation complexe qui existe entre sa mère et lui. Relation nécessaire mais aussi cauchemardesque. Constat fut fait qu’il n’y a aucune opposition entre cette mère et son fils. Il s’agirait plutôt d’une relation sans envers ni endroit, comme sur une bande de Moebius où ça circule de façon conjointe, avec nécessité de la présence de la mère. Ici, l’absence symbolique ne figure pas. Ce n’est que présence, présence perpétuelle à laquelle Robert a à faire. La présence de Robert dépend de la présence de sa mère chargée de dire afin qu’il puisse ensuite compléter ou préciser les choses. Pour traiter cette présence sans absence, Robert trouve des débrouilles en se branchant sur le micro et la dimension de la lettre. Cela est vital pour lui.
![]() Ce qui est frappant dans le cas de Robert, c’est qu’un espace énonciatif puisse se dégager pour lui, à partir de sa rencontre avec Catherine, constitué à partir d’un effort de transmission s’appuyant à la fois sur les lettres et les dessins. Et, pour Robert, comme cet espace n’est pas constitué, cela lui demande un effort permanent, quasi sans fin, parce qu’il n’y a pas d’absence. Robert a sans cesse affaire à la continuité, un monde non constitué sur un intérieur-extérieur, un haut-bas… ce qui le contraint en permanence à construire un espace où loger son corps. Et, dans cette dimension, la fonction de l’écriture, de la lettre est pour lui, fondamentale. Ainsi, pour Robert, l’utilisation de la matérialité de la lettre se présente comme une nécessité vitale, non isolable, mais permettant de créer un bord, voire d’introduire des distinctions pour lui, qui ne dispose pas des paires d’opposition.
Ce qui est frappant dans le cas de Robert, c’est qu’un espace énonciatif puisse se dégager pour lui, à partir de sa rencontre avec Catherine, constitué à partir d’un effort de transmission s’appuyant à la fois sur les lettres et les dessins. Et, pour Robert, comme cet espace n’est pas constitué, cela lui demande un effort permanent, quasi sans fin, parce qu’il n’y a pas d’absence. Robert a sans cesse affaire à la continuité, un monde non constitué sur un intérieur-extérieur, un haut-bas… ce qui le contraint en permanence à construire un espace où loger son corps. Et, dans cette dimension, la fonction de l’écriture, de la lettre est pour lui, fondamentale. Ainsi, pour Robert, l’utilisation de la matérialité de la lettre se présente comme une nécessité vitale, non isolable, mais permettant de créer un bord, voire d’introduire des distinctions pour lui, qui ne dispose pas des paires d’opposition.
![]() Et, dans cette dimension de l’espace et de la lettre, Robert forme une série de mots qu’il invente, ajoutant notamment un jour en plus au calendrier de ses doudous. Tentative pour lui de découper le temps, pouvant se rapporter à la question de la présence/absence chez Robert et qu’il essaie de traiter avec ses moyens ?
Et, dans cette dimension de l’espace et de la lettre, Robert forme une série de mots qu’il invente, ajoutant notamment un jour en plus au calendrier de ses doudous. Tentative pour lui de découper le temps, pouvant se rapporter à la question de la présence/absence chez Robert et qu’il essaie de traiter avec ses moyens ?
Robert est branché en permanence sur la lalangue, dont il fait un point d’appui, un partenaire. Par exemple, il va associer un « je n’arrive pas à penser » à un dessin d’une plante qu’il va inventer et qu’il nomme « aspenthique ». On voit là quelque chose avec la sonorité entre « pensé » et « aspentique ». Et, tous ces mots qu’il écrit lui permettent d’opérer une certaine distinction, un certain partage de l’espace. Et, ses hésitations quant à l’orthographe semblent indiquer que cette dernière tente de désamorcer l’énergie de jouissance, contenue dans le mot même. Toutes ces assonances sont chargées pour lui de façon pulsionnelle et deviennent moins dangereuses à manipuler dès qu’elles sont écrites de la bonne façon, pour lui.
Ainsi, par sa position de départ, dès l’accueil de cet enfant et de sa mère, Catherine, en insistant avec douceur, a situé Robert en position de corps parlant et elle-même en position de se laisser enseigner par lui, permettant l’éclosion d’un sujet, dans le dispositif. La mère de Robert va consentir à ce que le champ d’expérience s’élargisse. Point nouveau, ouvert par la façon de procéder de Catherine, dans sa façon de s’adresser à la fois à cette mère et à cet enfant.
Partant de là, Robert va expliquer comment il essaie de s’y prendre, avec cette présence perpétuelle, à laquelle il a à faire, nécessitant pour lui un travail permanent.
Alexia Lefebvre-Hautot
![]() Mercredi 29 mars
Mercredi 29 mars
Cette soirée sera animée par Marie-Hélène Pottier et Catherine Grosbois.
NB : Séance en visioconférence uniquement
Il s’agit d’un atelier de présentation d’une « étude de cas », articulée au résultat d’une conversation autour d’un élément éclairant la structure et les lignes de l’évolution d’un cas, entre l’imprévu des changements et le prédictible des répétitions des parcours de jouissances qui font le noyau des symptômes qui amènent les consultations.
La conversation se fait entre deux praticiens avec des expériences différentes.
Ici ce qui se rencontre c’est un trajet que je peux lire comme des actes posés comme insupportables, vers la possibilité de demander.
Ici, il s’agit d’un trajet qui s’installe après les premières rencontres, et qui a un aboutissement. Pourquoi ? Parce qu’il se rencontre là dès le début un désir décidé, qui fait que l’insupportable se fragmente en petits morceaux. Deux concepts sont à l’œuvre : les places de chacun, les lieux qui correspondent et les autres lieux qui ne correspondent pas à certains.
Et la construction d’une structure à quatre places, dont certaines ne sont pas occupées autrement que par une absence, s’inscrivant dans une temporalité. C’est donc la distinction des places et des noms et, du fait que la matière est de signifiant, la possibilité que l’absence ne soit pas un trou, mais une pure différence, distinction. Cela permet d’alléger la signification de catastrophe et la nécessité de la répétition. La substitution est alors possible. Donc la demande de quelque chose de désirable, c’est à dire quelque chose qui n’est pas là, qui manque.
Et qui peut alors construire du nouveau.
Catherine Grosbois
Le séminaire Janus Alpha + Bêta du 29 mars 2023, nous a réunis autour du cas présenté par Marie Hélène Pottier, intitulé « Le cas de Georges, un trajet de l’acte à la demande » et dont la lectrice était Catherine Grosbois. Voilà un extrait de notre étude et discussion :
C’est avec un « langage privé », des phrases qui ne cessent pas, où se succèdent des mots, sans interlocution, sans demande, sans adresse à l’Autre – qui n’existe pas pour lui – que Georges arrive à l’Association. Marie-Hélène, qui s’oriente de la psychanalyse lacanienne, se fait destinataire de cette langue. Celle-ci, sans S1, ne comporte pas de distinction possible. Le premier travail de distinction va être l’occasion d’introduire le S1, conduisant ensuite à faire série, ouvrant l’entrée dans un circuit. En effet, l’intervention, par l’écriture, de Marie-Hélène, va permettre l’introduction d’une ponctuation, ouvrant la voie au circuit pulsionnel. Cela vient marquer un coup d’arrêt à ce qui ne cessait pas, éclairant ce qui concerne, Georges directement. A partir de là, Georges va pouvoir établir des distinctions qui donne lieu à une articulation possible entre les différents éléments et une place laissée vide est rendue possible. Puis, Georges va se mettre à ranger, classer les différents éléments à sa disposition.
Un passage à l’acte, répété deux fois par Georges, permet de repérer l’impossibilité pour ce garçon de considérer le couple présence/absence. Cette question de la présence/absence, du Fort/Da1, introduite par Freud n’est pas l’affaire de Georges. Ce passage à l’acte réitéré n’est pas à entendre comme un loupé, mais exprime un « je veux voir maman », sans parole ni demande. Il s’agit là d’un pur agir, et donc quelque chose d’inscrit dans une dimension détachée de toute chaîne signifiante. Face à l’absence, et ce « je ne sais pas quand je vais revoir maman », Georges a à faire à une rupture, une disruption. Il s’agit de quelque chose d’énigmatique, qui surgit pour lui et le précipite dans l’acte. Marie-Hélène en demandant à Georges de préciser son « je ne sais pas », permet de ne pas inscrire Georges dans une causalité qui l’efface. Georges, peut alors déplier ce « je ne sais pas » qui le concerne plus spécifiquement ; il ne sait pas quand il ira chez sa mère. Marie-Hélène, tient compte de cet élément et propose à Georges de fabriquer un calendrier. Il y consent. A partir de là les choses s’apaisent pour lui. S’ensuit l’inscription de la temporalité, introduisant l’invention d’une fiole, qui le représente, et qui peut circuler en plusieurs lieux, avec la mise en place de temps différents. Ensuite, il y a l’invention du logo, une double casquette, le jeu minecraft, où il pioche, construit...
La discussion, a donné lieu à un échange précisant un point très précieux : si l’introduction de la place vide est nécessaire pour chaque être parlant, elle est cependant à distinguer du couple présence/absence.
Ce cas nous montre combien, ce n’est pas parce qu’il n’a pas accès au Fort/Da que rien n’est possible pour Georges. Ce fabuleux travail d’orfèvre, orienté par la psychanalyse lacanienne, permet à Georges de rabouter quelque chose. Autrement dit, là où il ne peut pas faire usage du Fort/Da, il invente la fiole, extrait de minecraft, puis il construit des objets, un personnage et rentre dans le jeu. Ainsi, s’il ne peut pas s’inscrire dans l’articulation présence/absence, pour autant, il utilise quelque chose se situant du côté de la quête du S1. Et, du moment où il a à sa disposition des S1, Georges va les distinguer. Cet usage singulier que Georges fait de certains objets, de circuits, permet de rendre manœuvrable quelque chose qui sans tout cela, ne tiendrait pas ensemble.
Tout ce cheminement, fait par Georges, la mise en place d’un circuit, rendue possible dans ses rencontres avec Marie-Hélène, laisse à Georges une certaine marge de manœuvre, ce sans quoi il est manœuvré ; c’est ce qu’il se passe quand il passe à l’acte.
Cette soirée, par l’étude du cas de Georges a, une fois encore, permis d’échanger autour des effets de l’accueil qui, grâce au discours de l’analyste qui soutient la position de Marie-Hélène, permet l’éclosion d’un sujet. C’est de la dentelle.
Alexia Lefebvre-Hautot
Note :
1 Freud S., « Au-delà du principe de plaisir » (1920)
![]() Mercredi 12 avril
Mercredi 12 avril
NB : Séance en visioconférence uniquement
Cette soirée sera animée par Marie Izard et Nathalie Herbulot.
Axel est un jeune garçon qualifié d’enfant violent et cela exaspère tant l’école qu’il ne sera accueilli qu’à mi-temps. Voilà une situation qui résonne avec la journée de l’Institut de l’enfant : « Enfants terribles, parents exaspérés ». Cette année, Nathalie Herbulot, psychologue de l’Education Nationale, décide de soutenir l’accueil à temps plein de cet enfant à l’école et la façon dont elle s’y prend m’a évoqué ce que dit Daniel Roy dans l’ouvrage collectif Enfants violents :
« Il s’agit de prendre en compte cette grammaire de la pulsion pour accueillir ces manifestations non pas comme des troubles mais comme des appels à trouver de nouveaux mots et de nouveaux échanges. Pour que l’enfant y parvienne, il faut au moins quelqu’un qui entende et qui accueille ces appels comme une première façon de s’adresser à l’autre. »
Nous verrons dans ce texte comment Nathalie soutient ensuite ce que l’enfant invente pour faire lien social dans l’école mais surtout pour se faire une place dans le monde.
Nous interrogerons, en prenant appui sur le texte de Jacques Alain Miller, « Orientation », toujours dans le même ouvrage collectif, la violence de cet enfant, de quoi est-elle le signe ? Peut-elle se symboliser ? Est-elle un symptôme ?
Quel trajet permet le dispositif mis en place par Nathalie à partir de ce « les choses à faire » ?
Marie Izard
![]() Mercredi 24 mai
Mercredi 24 mai
NB : Séance en visioconférence uniquement
Cette soirée sera animée par Serge Dziomba et Céline Guédin.
Dans cette séance du séminaire, Céline Guédin présentera un travail en cours avec une jeune femme. Les effets de l’amour-ravage y sont mis en valeur. On y voit, pour un sujet dans une grande précarité mentale, les effets de l’amour ravageant au point d’y perdre la vie possiblement. Ici l’amor rime avec la mort. Toutefois par des manœuvres appropriées Céline Guédin arrive à provoquer et soutenir un pas de côté de sa patiente qui semble l’éloigner un peu du risque mortifère. D’autres préoccupations peuvent alors paraitre. Elles engagent le corps vivant du sujet avec un léger décalage visible autour de son dire à l’endroit de son corps qui réclame des soins.
Serge Dziomba
![]() Mercredi 14 juin ANNULÉ et reporté au mercredi 21 juin
Mercredi 14 juin ANNULÉ et reporté au mercredi 21 juin
Cette soirée sera animée par Corinne Jean et Marie-Hélène Doguet Dziomba.
NB : Séance en visioconférence uniquement
Ce séminaire est organisé sous la responsabilité de Marie-Hélène Doguet-Dziomba.
Il aura lieu les mercredis 14 décembre 2022 ANNULÉ, 18 janvier, 8 février(*), 29 mars(*), 12 avril (*), 24 mai(*) 2023 + une séance « spéciale » le 14 juin ANNULÉE et reportée au 21 juin (*) 2023. Ces séances auront lieu à la Maison de la psychanalyse en Normandie à 20h30. Il y aura possibilité d’y participer en visio.
(*) Séance en visioconférence uniquement
Maison de la psychanalyse en Normandie,
48 rue l’Abbé de l’Epée, à Rouen (76).
Consulter le plan d’accès ».
Participation aux frais : 5 € par soirée ou 25 € pour l’année et pour l’ensemble des séminaires proposés par l’ACF-Normandie. Réduction de 50 % pour les étudiants.
Contacter Marie-Hélène Doguet-Dziomba pour obtenir des renseignements et s’inscrire
Revenir à L’ACF-Normandie » ou à l’Accueil du site ».
Accéder à l’Agenda ».